C’est une onde de choc, qui se propage lentement, souvent de façon chaotique, mais elle gagne incontestablement du terrain. Ces derniers mois, avec une ampleur inédite, plusieurs établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche ont poursuivi et sanctionné des enseignants accusés de harcèlement sexuel ou moral, et de comportements sexistes ou inappropriés.
C’est ce que montre l’enquête entamée en décembre par Mediapart, menée dans plusieurs universités ou instituts, au moyen de nombreux témoignages et documents.
Mais elle montre aussi que certaines procédures sont encore souvent marquées par des tâtonnements institutionnels, voire de graves dysfonctionnements, quand certains faits sont carrément ignorés ou minimisés.
Pour les spécialistes des violences sexuelles et sexistes, l’université semble aujourd’hui au milieu du gué, avec un effet #MeToo que personne ne nie (lire notre analyse).
- Les révocations de la fonction publique dans des centres prestigieux ne sont plus un tabou : l’exemple de l’Inria et du CNRS.
- L’université Paris I-Panthéon Sorbonne est secouée par deux affaires d’accusations de viol visant deux enseignants, dont des étudiants s’étaient déjà plaints.
- Les procédures sont parfois très longues, mais aboutissent à des sanctions jugées exemplaires : le cas de l’Ined.
- Les faits supposés sont parfois requalifiés après enquête de la présidence : la « distance requise » à Sorbonne-Université.
- Le manque de formation et de compétence contribue à des procédures chaotiques : le cas de Paris VIII.
Au CNRS et à l’Inria, la révocation n’est plus un tabou
Pour les militantes contre les violences sexuelles, c’est le changement le plus spectaculaire : le recours aux révocations de la fonction publique qui, jusque-là, à de très rares exceptions près, semblait tabou.
Selon nos informations, le très prestigieux Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique (Inria) a décidé, pour la première fois de son histoire, la révocation d’un responsable d’équipe projet dans un centre de recherches – soit la sanction la plus élevée dans l’échelle prévue par le code de l’éducation.
Agrandissement : Illustration 1

Plusieurs « signalements » sont remontés en octobre 2018 auprès de la direction de l’Inria, qui a aussitôt décidé de déclencher une commission d’enquête interne. « La Commission administrative […] a […] considéré que les faits étaient constitutifs de harcèlement sexuel, harcèlement moral et de comportement sexiste inapproprié », explique l’Inria, interrogé par Mediapart, sans révéler le nom du chercheur. La sanction est tombée le 6 mars 2019 – nous ne savons pas si cette décision a fait l'objet d'un appel.
Jamais l’Inria n’avait révoqué quiconque pour des violences sexistes et sexuelles. Et dans les cinq dernières années, c’est la première fois que l’Institut convoque une commission disciplinaire pour ce motif. Jusque-là, explique la direction, « deux signalements de comportements inappropriés » avaient conduit à des « avertissements ».
Des décisions semblables ont été prises en 2017 par le CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Un directeur de recherche a été révoqué le 19 octobre 2017, après que la commission disciplinaire a jugé qu’il avait eu, à l’égard de deux collègues femmes, « un comportement dénigrant et oppressant caractérisé notamment par des critiques répétées sur leur activité y compris devant des collègues, des insultes et des pressions », qui est qualifié de « harcèlement sexuel » par la commission disciplinaire.
Pour l’une des deux victimes, « jeune étudiante étrangère » qui était « placée sous [sa] responsabilité », le chercheur est allé « jusqu’à des faits d’attouchements sexuels », précise la décision rendue publique par le CNRS, dans une version anonymisée (à lire ici). Le document précise aussi qu’il a « tenu de manière répétée des propos à connotation sexuelle (blagues à caractère sexuel, remarques sexistes) ».
Dans un laboratoire du CNRS à Grenoble, c’est un chargé de recherche, à la tête d’un projet très bien doté en financements, qui a malgré tout été révoqué, lui aussi le 19 octobre 2017 (une décision à lire ici).
En cause : plusieurs témoignages faisant état (entre autres griefs) d’un « comportement déplacé à l’égard de certains personnels du laboratoire et notamment des personnels féminins assurant des fonctions de doctorantes » (et donc dans une position hiérarchique inférieure), de « propos grivois et à connotation sexuelle », des « commentaires sur les attributs physiques et des remarques sexistes ».
La commission disciplinaire parle également d’un comportement conduisant à « exercer une emprise » sur certains membres de son équipe, alors que le chercheur de Grenoble consommait, selon plusieurs témoignages, des « drogues dures, y compris sur le lieu du travail ».
À Paris I, deux plaintes pour viol
La présidence n’a pas cherché à se défausser. Quand nous avons interrogé l’université pour la faire réagir aux informations que nous avions recueillies, Paris I-Panthéon Sorbonne a assumé. Certains responsables étaient manifestement sous le choc.
Comme nous l’avons raconté dans cet article, en quelques mois, la prestigieuse université parisienne a été secouée par deux plaintes pour viol, visant deux de ses chercheurs, le géographe Yann Le Drezen et l’archéologue Guillaume Gernez.
Le premier, qui conteste les faits, est visé par plusieurs autres témoignages, pour « harcèlement sexuel et moral » selon la section disciplinaire, qui lui a infligé une suspension d’un an. Une sanction jugée trop faible par la présidence, qui a fait un recours auprès du Cneser disciplinaire (le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche).
De plus, en 2014, une étudiante s’est déjà plainte de son comportement – cela s’était conclu par un « rappel à l’ordre » informel, selon nos informations.
Le second enseignant-chercheur visé, Guillaume Gernez, vient quant à lui d’être suspendu à titre conservatoire, après qu’une étudiante a porté plainte pour viol fin février. Le chercheur avait été sanctionné d’un abaissement d’échelon en 2014, après le témoignage d’une étudiante relatant un « comportement déplacé ».
Ils bénéficient du droit à la présomption d'innocence, leur responsabilité n'ayant pas été définitivement établie.
À l’Ined, un long processus pour une sanction jugée exemplaire
En février 2019, c’est à l’Ined, l’Institut national d’études démographiques, qu’un chargé de recherche a été lourdement sanctionné : Léonard Moulin, spécialiste (entre autres) des frais d’inscription à l’université, a été exclu temporairement de la fonction publique, pour une durée de deux ans, dont six mois avec sursis.
Cette sanction n’est pas définitive, le chercheur ayant indiqué l’avoir contestée devant le tribunal administratif.
Agrandissement : Illustration 2
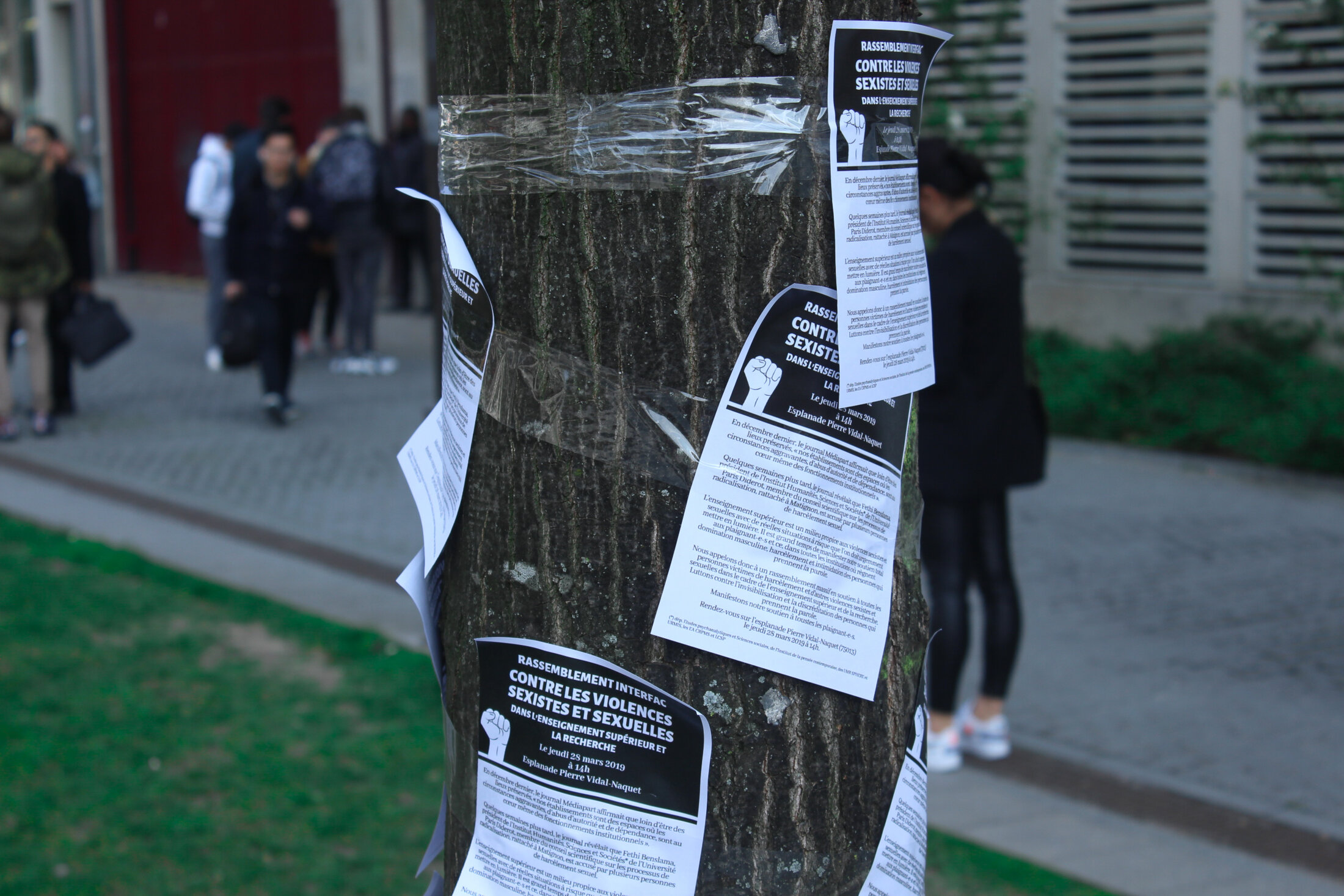
La décision, consultée par Mediapart, est fondée sur de nombreux témoignages « convergents », faisant état de « comportements et propos inappropriés, notamment à caractère sexuel », « vis-à-vis de plusieurs doctorantes et personnels de sexe féminin », et « de nature à porter atteinte à leur dignité », qui « avaient un caractère dégradant, offensant et déstabilisant ».
La commission disciplinaire estime également que le harcèlement sexuel est constitué pour « une des doctorantes de l’Ined avec laquelle il a entretenu une relation, notamment en ayant eu, après sa rupture, un comportement dénigrant et humiliant à son égard, sur le lieu de travail ».
L’économiste, membre du collectif des Atterrés, a également « recherché des faveurs sexuelles de plusieurs doctorantes ou membres du personnel féminin de l’Ined », et tenu « à plusieurs reprises des propos grivois et à connotation sexuelle (blagues à caractère sexuel, commentaires sur les attributs physiques et remarques sexistes) », selon la décision consultée par Mediapart.
La commission disciplinaire a souligné la position de « vulnérabilité » des doctorantes de l’Ined, en raison de la précarité de leur statut – quand lui est, à 32 ans, déjà chercheur titulaire, avec des travaux remarqués par ses pairs (sa thèse a été récompensée de plusieurs prix) et déjà des apparitions médiatiques (par exemple sur Mediapart).
L’économiste « n’a à aucun moment mesuré la gravité de ces faits, évoquant notamment des “bêtises” ou des “blagues potaches” », précise encore la décision.
Léonard Moulin, lui, nie les faits. Pour sa défense, il a produit plusieurs témoignages soulignant notamment sa valeur scientifique – que personne ne conteste et qui n'est pas ici le propos – mais qui ne contredisent pas les récits, nombreux et « convergents », produits devant les enquêteurs de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), selon la commission disciplinaire.
Interrogé par Mediapart, le chercheur a refusé de répondre à notre demande d’entretien, précisant simplement qu’il contestait la sanction auprès du tribunal administratif de Paris.
L’Ined ayant saisi le procureur de la République de Paris en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, une enquête préliminaire est en cours. De source judiciaire, elle a été confiée à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la préfecture de police de Paris.
Selon nos informations, au moins trois plaintes ont été déposées, pour harcèlement sexuel et pour agression sexuelle, et Léonard Moulin a été placé en garde à vue courant avril et remis en liberté. Il est présumé innocent.
À l’Ined, la procédure a laissé des traces. L’ambiance y est parfois décrite comme pesante. L’Institut a d’ailleurs mis en place une formation en interne « pour les personnes qui souhaitaient reparler de ce qui s’est passé dans l’établissement et qui a été source de stress et d’inquiétude », explique à Mediapart la directrice Magda Tomasini.
Il faut dire que la procédure a été très longue et qu’elle a souffert, du moins au début, de tâtonnements, voire de maladresses, dans un centre de recherche qui n’avait jamais été confronté à une situation similaire. En cause : un manque de formation sur ces questions. Un comble pour l’Ined, qui publie une enquête de référence sur les violences sexuelles (Virage).
Ainsi, il a fallu attendre huit mois entre les premiers signalements, en juin 2018, et la sanction de la commission disciplinaire. Selon plusieurs témoignages, plusieurs chercheurs de l’Ined, alertés en amont, n’auraient pas fait remonter les signalements ; la médecine de prévention aurait quant à elle informé partiellement la direction de l’Institut ; l’anonymat des témoins n’aurait pas toujours été garanti au début de la procédure, etc.
Pour le mis en cause, cette durée a aussi eu des conséquences : il a été suspendu à titre conservatoire pendant quatre mois. Mais au terme de cette période, l’enquête n’étant toujours pas close, l’Ined lui a demandé de travailler à domicile, avant que la sanction n’intervienne plusieurs mois après.
Magda Tomasini, qui a refusé de s’exprimer sur le détail de la procédure, reconnaît sans détour la difficulté engendrée par la durée du processus. « Il y a un risque de donner l'impression de “laisser traîner”. »
Mais elle pointe aussi l’importance pour les victimes d’avoir du temps. « Dans ce type d’affaire, il y a un temps nécessaire à la prise de conscience par les victimes de leur situation, explique-t-elle. Il y a aussi la peur de se retrouver stigmatisées par une communauté de travail, qui va au-delà de la communauté de l’établissement. Il y a l’appréhension de ne pas être crues. »
D’ailleurs, précise la directrice de l’Ined, « beaucoup d’éléments sont apparus entre les premières alertes et la décision ». « À l’inverse, il faut garantir que la présomption d’innocence soit respectée et qu’aucune décision qui pourrait s’apparenter à une sanction sans fondement ne soit prise », rappelle-t-elle.
L’Ined doit démarrer prochainement un plan de formation pour « sensibiliser au harcèlement sexuel » l’ensemble des personnels, à l’issue duquel une charte de bonnes pratiques devrait être rédigée.
L’Institut n’est pas le seul à s’être engagé dans des procédures très longues, en externalisant l’enquête à l’IGAENR : c’est aussi le choix qu’avait fait l’université Paris-Diderot, dans une procédure visant notamment le psychanalyste Fethi Benslama.
Selon nos informations, lancée mi-novembre, l’enquête interne est toujours en cours.
De la « distance requise » pour un professeur d’université
« J’en ai marre de vivre avec la peur des représailles. » Quand Emma* a appris que Sorbonne-Université réfutait tout harcèlement moral et sexuel de la part de son ancien directeur de thèse, elle n’en a pas dormi de la nuit. Elle avait pourtant été convoquée devant une commission d’enquête, et l’audition avait duré « trois heures ».
« En fait, c’est presque pire que s’ils avaient tout balayé d’entrée de jeu. Là, on nous a écoutées. J’ai pleuré devant eux. Ils ont vu notre détresse. Et rien ! Notre personne est niée », poursuit Emma.
En réalité, selon nos informations, son ancien directeur Andrew Diamond sera bien convoqué devant une section disciplinaire, mais pour non-respect de la « distance requise » pour un fonctionnaire. Une notion qui renvoie à une décision du Conseil d’État du 18 décembre 2017, visant à l’époque un maître de conférences de l’université voisine Paris I-Panthéon Sorbonne (il s’agit d'un archéologue, visé par une nouvelle procédure depuis).
C’est la conclusion à laquelle est arrivée la commission d’enquête mise en place par Sorbonne-Université, à propos du spécialiste d’histoire et de civilisation américaines, auteur d’ouvrages sur Chicago, dont Histoire de Chicago (éditions Fayard, 2013, coécrit avec Pap Ndiaye), directeur de l’unité de recherche « Histoire et dynamique des espaces anglophones : du réel au virtuel ». Lui parle d’une « accusation injuste » qu’il a « toujours contestée absolument ».
Le rapport de la commission, remis mi-avril 2019, « exclut le harcèlement sexuel et moral » mais reconnaît des aspects « problématiques » dans le « comportement professionnel » et la « qualité de l’encadrement comme directeur de thèse », a appris Mediapart auprès de l’université.
Dans cette procédure, au moins huit personnes – sept femmes et un homme témoin – ont déclaré avoir subi ou assisté à des « propos ou des comportements à connotation sexuelle », une « confusion entre vie professionnelle et vie privée », et « l’instauration de situations de vulnérabilité et de dépendance », selon le courrier adressé par l’association Clasches à la présidence en juin 2018.
Parmi les témoignages envoyés et consultés par Mediapart, on retrouve des récits souvent convergents de doctorantes, d’étudiantes et d’une maîtresse de conférences, rapportant leur gêne, voire leur malaise, allant jusqu’à fragiliser leur position universitaire.
Plusieurs d’entre elles y décrivent une « sensation très désagréable d’être déshabillée du regard » ; racontent que le professeur aurait posé des « questions sur [leur] vie personnelle » ; qu’il les aurait invitées à un « apéritif » chez lui ou qu’il les retrouvait dans des bars à la sortie d’un cours ou d’un séminaire ; qu’elles mettaient en place des « stratégies d’évitement » ou réfléchissaient à leur tenue quand elles avaient rendez-vous avec lui.
Une docteure – désormais maîtresse de conférences dans le sud de la France – a aussi raconté avoir très mal vécu une audition pour un poste, où le professeur était membre du jury, comme elle l’a confirmé dans une attestation adressée à l’université. Elle y évoque des regards « particulièrement insistants » sur son « chemisier » et ses « jambes ».
Deux femmes évoquent aussi un geste déplacé – « il m’a caressé le dos, pendant plusieurs secondes », raconte Emma, l’ancienne doctorante, selon le récit fourni à la commission d’enquête. Une ancienne étudiante a affirmé avoir « le souvenir distinct » que lors de sa soutenance de mémoire, en master 1, Andrew Diamond « a fait glisser son pied le long [de mon] pied pendant l’entretien ».
Plusieurs rapportent aussi avoir eu des relations d’encadrement douloureuses. Depuis, trois de ses doctorant·e·s ont changé de directeur de thèse.
Aucun harcèlement sexiste, sexuel, ou moral, n’a été retenu, mais un manque de « distance ». Andrew Diamond nie les faits. Interrogé par Mediapart, il a refusé de répondre à nos questions. Par mail, il a simplement écrit : « J'ai été informé en juin dernier d'une plainte pour harcèlement sexuel à mon encontre, accusation injuste que j'ai toujours contestée absolument. J'ai eu confirmation […] que mon université a écarté cette accusation au bout d'une longue enquête et a reconnu que cette accusation était totalement infondée. »
Il a fallu de longs mois pour en arriver là : les premiers témoignages sont parvenus à la présidence de l’université en juin 2018, par l’intermédiaire de Clasches. Laquelle association n’a d’abord reçu aucune réponse. Il a fallu plusieurs relances pour que Sorbonne-Université réagisse en ouvrant une enquête administrative en… janvier 2019. Pour un rapport rendu en avril 2019. Au total, il aura fallu près d’un an pour qu’une décision soit prise.
Les étudiants impliqués dans la procédure s’émeuvent aussi d’un sentiment de deux poids, deux mesures. Alors que l’université a semblé lente à réagir sur leurs témoignages, le doyen, Alain Tallon, a été prompt à saisir le procureur de la République de Paris pour diffamation, via l’article 40, à la suite de messages envoyés par deux étudiants sur des groupes Facebook (les masters 1 et 2 d’anglais, et les licences 1, 2 et 3 d’anglais).
Ils y avertissaient leurs camarades de promotion des accusations portées contre Andrew Diamond…
« Globalement, à partir du moment où j’ai pu enfin en parler, j’espérais beaucoup plus de l’institution, explique Emma* à Mediapart. À tous les niveaux, des choses sont faites, mais elles sont très timides, et très limitées. » Aujourd’hui, elle n’est plus inscrite à Sorbonne-Université. Pas davantage que Nicolas*, le seul homme à avoir témoigné dans le dossier constitué par Clasches, et qui a lui aussi quitté cette faculté : « Le manque d’informations sur la procédure est lunaire. Le manque de courage de l’université, et le temps que ça prend, aussi. »
Saisie par l’association, l’université a refusé de communiquer à ses anciens étudiants les résultats de l’enquête.
À Paris VIII, le naufrage de la procédure disciplinaire
Installée au cœur de Saint-Denis, l’université Paris VIII se targue souvent de son progressisme. On y trouve de nombreux spécialistes du genre, des associations étudiantes extrêmement actives sur ces sujets, on y organise des colloques pointus. L’institution, elle, est totalement dépassée.
C’est ce qui ressort du dossier de Aina*, que l’on rencontre dans les locaux de l’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT). Défendue par l’avocate Maude Beckers, elle est maîtresse de conférences à Paris VIII et attend depuis bientôt un an et demi que le signalement qu’elle a adressé à la présidente de son université débouche sur une décision.
Selon son témoignage, son directeur de département aurait tenu devant elle, à plusieurs reprises, des propos à connotation sexuelle, et aurait effectué un geste déplacé le 15 juin 2017. Aina vient alors d’être recrutée pour rejoindre l’équipe de Mathieu Guidère, un chercheur spécialiste de l’islam, auteur de très nombreux ouvrages et régulièrement invité sur les plateaux télé (et cité dans Mediapart), notamment à propos du terrorisme djihadiste.
« Et tu es vierge, je suppose », lui aurait-il ainsi demandé, selon l’attestation remise à l’université. Ou encore : « Je ne comprends pas pourquoi des filles arabes, belles, intelligentes et talentueuses sont coincées au niveau sexuel. »
Ce 15 juin 2017, Guidère aurait aussi glosé sur les relations sexuelles hors mariage, et interprété un passage célèbre du Coran pour justifier l’adultère. « Embarrassée et sidérée, j'arrivais à peine à prononcer quelques mots », rapporte la jeune femme dans son témoignage écrit.
Mathieu Guidère l’aurait ensuite accompagnée à la gare où l’attendait son train de retour. Dans la foule, le directeur aurait été encore plus loin. « Il était derrière moi. Il y avait du monde, il en a profité pour se coller à moi et glisser sa main sur le bas de mon dos et le haut de mes fesses tout en continuant à me parler normalement. » L’universitaire aurait encore insisté pour qu’elle reste à Paris et il l’aurait invitée chez lui à plusieurs reprises.
Aina hésite alors à refuser le poste à Paris VIII, selon plusieurs témoignages de collègues lyonnais. « J’ai dissuadé ma collègue de démissionner, malgré son insistance, car cela lui aurait été préjudiciable pour sa carrière », témoigne ainsi un professeur de Lyon II, alerté dès la fin juin 2017, dans une attestation produite dans la procédure à Paris VIII.
Un autre confirme par écrit : « Ce n’est que sur les conseils de plusieurs de ses collègues arabisants et de moi-même qu’elle a accepté de signer à contrecœur son PV d’installation [à Paris VIII – ndlr]. »
Aina retourne à Paris début septembre pour la réunion de rentrée. Très vite, ses relations avec Guidère se dégradent – selon des messages consultés par Mediapart, il lui reproche d’être partie avant la fin d’une réunion, d’avoir utilisé un mail collectif pour s’en excuser ; il exige d’être en copie de ses mails à l’administration ; il lui indique que ses étudiants se plaignent de ses cours.
C’est l’organisation par Mathieu Guidère, le 1er décembre 2018, d’un colloque sur les femmes dans le monde arabe qui va décider Aina à s’ouvrir à trois de ses collègues parisiens. En appui, ils dénoncent des « pressions, dysfonctionnements et harcèlement moral qu’ils subissaient de leur côté » – selon les témoignages qu’ils ont apportés dans le cadre de l’enquête menée par l’université.
Mathieu Guidère conteste catégoriquement les faits rapportés par Aina. Dans une attestation, que Mediapart a consultée, il confirme avoir eu un échange en privé à la demande de sa nouvelle collègue, le 15 juin 2017. Mais pour le reste, tout diverge.
À aucun moment il ne lui a fait la moindre proposition sexuelle, ni eu le moindre geste déplacé, assure-t-il. Par écrit, il indique que c’est même Aina qui lui « fait du charme », pour obtenir un aménagement de son emploi du temps. Il suggère aussi que les détails qu’elle lui donne alors sur ses problèmes de santé l’auraient de toute façon dissuadé.
« Je n’ai à son égard aucun mot ni geste déplacé, à aucun moment », écrit-il. Pour sa défense, il cite aussi des mails de juin dans lesquels elle écrit : « merci beaucoup boss/enfin un travail, un endroit où je vais me sentir bien […] bises ».
Quant à la dégradation de leurs relations de travail, Guidère en a une perception toute différente. « X n’a jamais exprimé une quelconque gêne à mon égard ni ne m’a dit que mes rares mails la gênaient ou lui posaient un quelconque problème », affirme-t-il à l’écrit.
Quand nous le rencontrons, il refuse d’abord de nous répondre si nous publions son nom, puis finit par accepter. Mais à condition de relire ses citations, dont il a ensuite contesté la teneur et la formulation.
Pendant près de trois heures, Mathieu Guidère, qui bénéficie de la présomption d’innocence, a nié méthodiquement les faits reprochés, et a justifié les poursuites engagées contre lui par ses engagements contre l’islam radical.
« Il y a eu pendant longtemps des accommodements avec le sectarisme que je n’ai pas cautionnés et qui ont conduit à une alliance de fait contre moi, entre des personnes que rien ne devait unir, l’une d’elles a instrumentalisé le dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour assurer sa titularisation en m’accusant », nous écrit-il par mail.
« Certaines étudiantes qui suivaient mon cours d’islamologie avaient enlevé leur voile mais certains collègues avaient demandé à l’une d’elles d’entreprendre le nécessaire pour me faire tomber pour harcèlement sexuel », poursuit Mathieu Guidère.
Et les témoignages venus de Lyon produits par Aina proviennent « de gens avec qui je suis en conflit », nous a-t-il dit. « L’un d’eux ne m’a jamais pardonné d’avoir travaillé pour le ministère de la défense entre 2003 et 2007 », affirme Guidère.
« Nous sommes face à une instrumentalisation du harcèlement sexuel pour le marginaliser », affirme aussi son avocat Rémi-Pierre Drai. Ému, Guidère conclut l’entretien de trois heures : « Ils ont détruit ma vie. Rien ne sera plus comme avant. Quand vous êtes innocent, c’est horrible… »
« Nous avons besoin de nouvelles façons de travailler »
Aucune décision n’a encore été prise. Au départ, pourtant, tout a été rapide : Aina et trois de ses collègues sont reçus à la présidence de l’université en décembre 2017. Tous les services compétents sont saisis, la chargée de mission égalité, le dispositif prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le médecin du service prévention… Le 9 janvier 2018, la présidente de Paris VIII saisit la commission disciplinaire. Le 11 janvier, Guidère est suspendu. La justice est également saisie par l’université, via l’article 40 du code de procédure pénale.
L’université décide d’accorder la protection fonctionnelle (qui permet, par exemple, la prise en charge des frais d’avocat par l’université) à Mathieu Guidère à la fin du mois de février. Ce n’est que le mois suivant que son accusatrice l’obtiendra…
Agrandissement : Illustration 5

Le professeur a par ailleurs été assisté lors de la procédure par un avocat, Rémi-Pierre Drai, qui faisait partie des conseils de l’université. Ce n’est que dans un second temps que Paris VIII a cessé sa collaboration avec lui, précise-t-on à la présidence.
Surtout, la section disciplinaire, chargée d’instruire le dossier, va exploser en vol. La procédure est chaotique. Les témoins ne sont pas tous auditionnés. Les membres de la section – qui n’est pas paritaire comme elle le devrait – se déchirent sur les suites à donner : deux d’entre eux demandent des éléments complémentaires ; le président refuse, ou ne donne pas suite. Les récalcitrants démissionnent, rendant de fait caduque la section disciplinaire.
Fin mai, une des membres écrit dans sa lettre de démission que sa « position n’est absolument pas liée à l’attente d’un verdict précis » mais « aux dysfonctionnements dans le traitement d’une affaire délicate ».
« Je ne demandais qu’une chose : que l’institution se donne les moyens de résoudre rigoureusement cette enquête… quelle qu’en soit l’issue », poursuit Marguerite Chabrol, professeure à Paris VIII en études cinématographiques, dans un courrier obtenu par Mediapart. « Tout est fait pour enterrer une affaire de ce type sans la résoudre », juge-t-elle, avant de demander une « enquête interne » à la fac, « dans la mesure où cette affaire met en cause toute la chaîne hiérarchique ».
Dans un mémo informel daté du 19 juin 2018, dont Mediapart a obtenu copie il y a plusieurs mois, la chargée de mission égalité femmes-hommes de Paris VIII refuse de se prononcer sur le fond, mais pointe des « dysfonctionnements », des « manquements à la déontologie » et des « vices de procédure », « portant préjudice à un fonctionnement équitable de la section disciplinaire et engageant la responsabilité de l’université ».
Exemple : les membres de la commission n’ont reçu aucun document sur leur rôle, ou de guide sur les violences sexuelles ou sexistes. « Une des conséquences de ce manque d’information a été l’insistance, au long de la procédure, à dissocier ce qui relevait du harcèlement sexuel et ce qui relevait du harcèlement moral. Or tant au pénal qu’au civil, le harcèlement sexuel ne peut être dissocié d’un contexte de harcèlement moral qui le rend possible », écrit Hélène Marquié (professeure à Paris VIII et spécialiste du genre) dans ce document adressé à la présidence de l’université – contactée par Mediapart, elle n’a pas voulu s’exprimer sur ce dossier.
D’après ce rapport, des pièces ont également été perdues. La présidente de l’université, citée par Guidère dans un mail, n’a pas été convoquée. « L’accueil réservé aux témoins a été tout à fait inacceptable, témoignant d’un traitement particulièrement inégalitaire entre les deux parties », dénonce encore Hélène Marquié.
Selon plusieurs personnes impliquées dans le dossier, la présidence a semblé au mieux passive, laissant les témoins sans information, y compris sur les suites de la procédure, au pire en soutien de la personne mise en cause.
À l’étage de la présidence, personne ne nie les difficultés que l’université a rencontrées. Tout semblait nouveau – personne n’a en effet gardé la mémoire de procédures disciplinaires pour des violences sexuelles dans cette faculté. « Nous avons eu des cas, bien entendu, mais pour deux d’entre eux, l’université n’était pas compétente, et pour le troisième, il s’agissait d’un chargé de cours dont le contrat n’a pas été renouvelé », explique la présidente Annick Allaigre. « Dans notre université, nous manquons parfois de formalisme, ce qui peut avoir ses limites. Nous travaillons justement pour améliorer cela, notamment pour les situations de ce type », reconnaît-elle.
Elle assume aussi un positionnement de « neutralité ». « On avait deux personnes qui se déclaraient en souffrance… Pour nous, c’est une situation très dure, justifie Annick Allaigre. Et je tenais à une certaine neutralité. »
Pour la suite, Paris VIII a semble-t-il commencé à prendre la mesure de son retard en matière de violences sexistes et sexuelles. Plusieurs programmes sont en cours d’élaboration, avec la mise en place d’une cellule d’écoute dédiée externalisée pour la rentrée 2019, la mise en place d’un comité de pilotage mêlant différents services, et un plan de formation des personnels, dont l’ampleur dépendra du budget que la fac pourra dégager.
« Nous avons besoin de nouvelles façons de travailler », explique-t-on à la présidence. Annick Allaigre l’admet : « Notre retard est d’autant plus regrettable que nous sommes à Paris VIII, où nous menons de nombreux projets sur les questions de genre, en termes de formation et de recherche (département de genre, DU violences faites aux femmes, formation tout au long de la vie sur la prévention du sexisme ordinaire au travail…), où les étudiants sont très mobilisés sur ces sujets, et où nous faisons partie des premières universités à avoir mis en place, l’année dernière, le prénom d’usage… L’hiatus entre ces actions et la prise en charge des violences sexuelles est difficile à admettre et nous incite encore plus à travailler sur ces sujets. »
C’est désormais au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) d’apprécier les suites à donner à ces faits, saisi comme le prévoit le code de l’éducation (R 232-31) – aucune date n’a pour l’instant été communiquée. Quant à la justice, elle n’a pas davantage donné de nouvelles – Aina ayant été entendue par la police le 13 mars 2018. Interrogé par Mediapart, le parquet de Bobigny n’a pas donné suite.
Le Défenseur des droits a également été saisi, le 17 juillet 2018. Aucune décision n'ayant été rendue, le professeur mis en cause est présumé innocent.