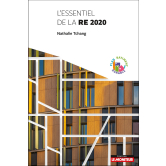Quelle contribution l’approche du paysagiste apporte-t-elle à la réflexion sur le risque incendie ?
La communication officielle joue sur le registre de la peur. Elle imprime le vocabulaire de la lutte armée dans l’imaginaire collectif, au service de la doctrine de la DFCI, la défense des forêts contre l’incendie. Le paysage change cette focale d’abord sur le plan temporel, pour s’interroger : quels signaux apportent l’irruption des grands feux comme celui de Gonfaron, en 2021 dans le Var, puis l’an dernier sur la Côte atlantique ?
Les succès indéniables de la DFCI, dans le temps court des catastrophes, ont fini par rendre les risques invisibles au quotidien. Cela introduit un biais de confiance dans l’esprit du public qui se dit : « Il y aura toujours un pompier pour protéger ma maison ». Or, les grands feux changent les priorités : après les évacuations, la défense des matériels et de l’immobilier ne prime plus, quand le respect des obligations légales de débroussaillement fait défaut. Cette analyse conduit à faire remonter l’enjeu vers la responsabilisation du gestionnaire de la forêt.
Comment dessiner des projets, à partir de cette analyse ?
Le cadre légal national de la Politique de prévention des forêts contre l’incendie se décline dans des plans départementaux relayés dans des Pidaf et des PPRIF (ndlr : plans intercommunaux de débroussaillement et d’aménagement forestier, plans de prévention des risques d’incendie de forêt). Mais que pèsent ces outils du code forestier qui s’ajoutent aux autres schémas planifiés par les collectivités locales pour leur développement urbain, économique, énergétique, social ou agricole ? L’invisibilisation du risque résulte d’une perte de relation culturelle, après la disparition des pratiques d’écobuage et de récolte du bois. L’exode rural a coupé le lien.
La reconstruction d’un imaginaire collectif, fédérateur et performatif, doit s’inscrire dans une logique de transformation, car la référence aux feux passés ne fonctionne plus, avec l’arrivée de nouveaux phénomènes qualifiés d’hors norme. Pour regarder vers l’avenir, les pompiers nous apprennent la science du feu. Aux paysagistes de la traduire dans l’urbanisme, pour passer d’une juxtaposition d’outils à un projet qui intègre cette science dans l’identité du territoire.
Le risque d’inondation peut-il contribuer à inspirer l’aménagement au service de la prévention des incendies ?
La compétence intercommunale de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations familiarise les pouvoirs publics avec une approche interministérielle et multi-service du risque. Cette méthode a incité à réfléchir à la durabilité des digues, et à la nécessité de réfléchir à l’échelle des bassins versants. Face aux inondations comme à l’incendie, un nouveau partage des responsabilités se dessine, pour mettre en cohérence le risque et l’urbanisme, en sortant de la temporalité des catastrophes.
Qu'attendez-vous de la recherche ?
Le croisement entre risque et paysage invite à des recherches pluridisciplinaires, comme je m’en rends compte à l’école d’architecture de Marseille où j’enseigne à l’Atelier des horizons possibles. L’enjeu consiste à sortir le risque incendie du domaine exclusif du code forestier, alors que l’urbain fait partie des facteurs qui peuvent l’aggraver. Il s’agit également de sortir du périmètre des parcelles, pour repenser le patrimoine des années 1970 et 1980, à l’interface entre ville et forêt, et progresser vers une vision systémique du risque.
Un projet doctoral en cours de montage, pour les trois prochaines années, permettra d’approfondir la compréhension des enjeux urbains de l’incendie, en coopération avec les parcs naturels régionaux des Alpilles, des Pyrénées catalanes et des Landes de Gascogne. En rassemblant l’architecture, l’urbanisme et le paysage, l’institut méditerranéen ville et territoire, qui démarre à la rentrée, incite à l’approche pluridisciplinaire que je souhaite appliquer à la prévention des feux.
Avez-vous pu expérimenter cette méthode dans des projets réels ?
Pour la réhabilitation du massif des Maures après l’incendie de Gonfaron, l’équipe de maîtrise d’œuvre à laquelle j’ai participée s’est appuyée sur huit diagnostics thématiques incluant notamment la forêt, la biodiversité et la prospective climatique. Plutôt que de systématiser les replantations, l’idée de composer avec les dynamiques présentes a permis de flécher les crédits sur d’autres priorités : préservation de la qualité des sols, prévention de l’érosion, création de zones charnière…
Le cahier des charges demandait le gommage des souches calcinées qui servent de perchoirs, ce qui facilite la dispersion des graines et l’autorestauration de la forêt. Nous avons pris le contrepied de cette prescription d’invisibilisation du risque. Face à l’héritage de milieux fermés et hautement inflammables, les réponses privilégient l’hétérogénéité spatiale et la diversité de peuplements. Ce parti permettra de limiter les interdictions de fréquentation des massifs qui se heurtent à une forte demande sociale, grâce à des espaces tampon rouverts à l’agriculture, et notamment au pastoralisme.
L’incendie de Gonfaron a aussi montré les conflits potentiels entre la protection de la biodiversité et la prévention des incendies. Comment en sortir ?
Le blocage s’est manifesté à propos de la torture d’Herman. L’option radicale de mettre fin à la gestion aurait eu des effets potentiellement dramatiques, tant du point de vue du risque incendie que de la biodiversité : les forêts fermées peuvent se révéler très préjudiciables à la faune et à la flore. Au contraire, l’idée d’une mosaïque hétérogène répond au besoin de diversité de milieux.
La loi du 10 juillet dernier facilitera-t-elle le développement de ce type d’approche ?
Le seuil de 20 hectares, au lieu de 25, pour les plans de gestion imposés à la forêt privée, ne produira pas d’effet significatif, compte tenu de l’éparpillement du foncier. La loi améliore certes la prévention, mais elle continue à situer le risque à l’échelle individuelle.
Or, il s’agit d’un enjeu métropolitain. Penser l’incendie, c’est penser la ville, en particulier les transports et l’énergie. Le vrai chantier d’avenir concerne les territoires ruraux et périurbains sous influence métropolitaine. Sa réussite reposera sur une médiation et des ingénieries pluridisciplinaires.
Tout en se conformant à la loi, les projets amèneront chaque partie prenante à un pas de côté, pour comprendre l’autre, rester humble face à ce qui nous échappe et mettre en avant l’idée de composer avec l’incertitude. A cette condition, la prévention de l’incendie apparaîtra comme un nouvel art de vivre dans un espace géographique et culturel riche de ses couleurs.